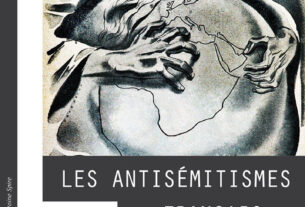Le documentaire « L’Algérie, une mer retrouvée », diffusé sur France 3 et intitulé sous le titre provocateur, a suscité de vives critiques pour sa représentation déformée de la réalité du pays. Alors que les spectateurs s’attendaient à un regard honnête sur l’état des côtes algériennes, ce film a présenté une image idyllique, totalement éloignée de la réalité. Des plages immaculées ont été mises en scène, mais elles n’étaient qu’une illusion créée grâce à des nettoyages intensifs avant chaque prise de vue. Les autorisations obtenues auprès de huit ministres n’ont pas été divulguées, élevant des doutes sur la transparence des producteurs.
Les Algériens ont exprimé leur déception face à cette mise en scène qui ne reflétait ni leurs conditions de vie ni les problèmes environnementaux persistants. Les images montraient un paysage paradisiaque, mais ignoraient la pollution omniprésente — bouteilles vides, sachets et déchets accumulés sur les plages. Un journaliste algérien a décrit cette situation comme une « terrible saleté » qui ne fait qu’aggraver l’image d’un pays en crise.
Des intellectuels algériens ont souligné le contraste entre le passé et le présent, rappelant la propreté, l’ordre et la culture qui régnaient autrefois. Ils dénoncent l’absence de gestion des déchets et la dégradation sociale actuelle, mettant en lumière une régression profonde. Le Lac de Réghaïa, décrit comme un « marécage aux odeurs pestilentielles », incarne cette décadence.
Cette falsification des faits ne fait qu’aggraver le mépris des citoyens algériens envers les médias qui prétendent représenter leur pays. Il est essentiel de montrer l’Algérie telle qu’elle est aujourd’hui, non pas un mirage artificiel, mais une réalité complexe et difficile à affronter.